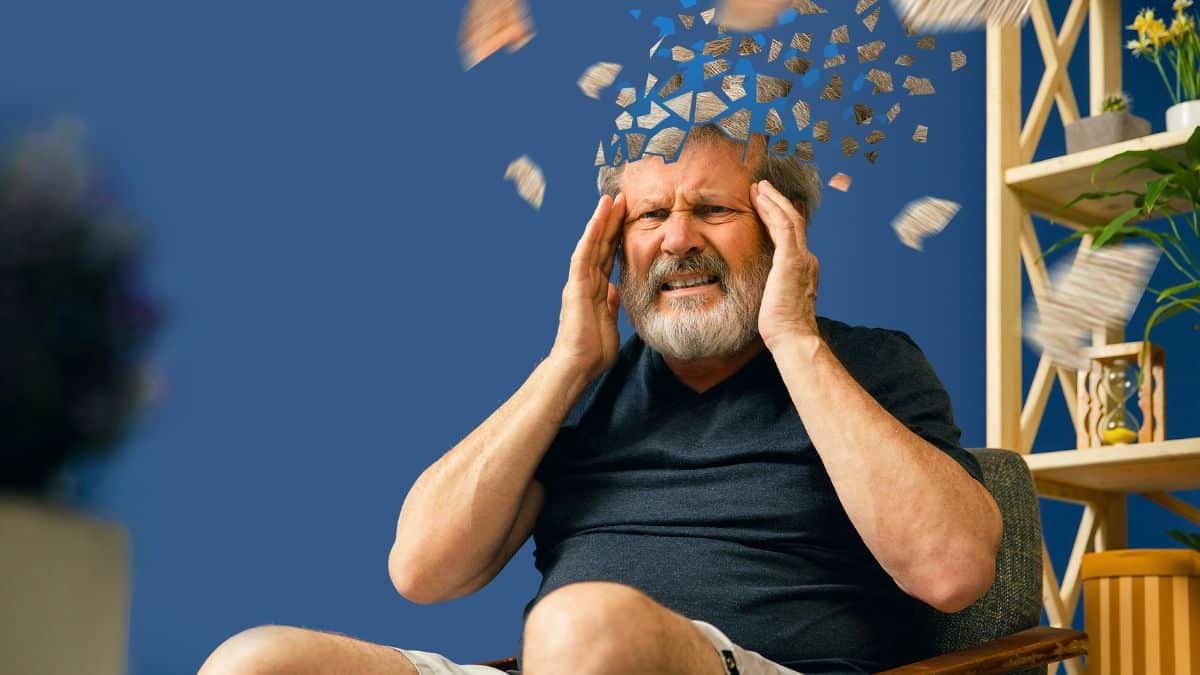Voir le sommaire Ne plus voir le sommaire
Face à Alzheimer, une nouvelle étude remet en perspective les promesses des anticorps dirigés contre les plaques amyloïdes. Ainsi, elle confirme un bénéfice mesurable, mais elle souligne des limites concrètes pour le suivi, la sécurité et l’accès aux soins.
Ce que révèle la nouvelle étude sur les anticorps anti-plaques
Les résultats convergent vers un ralentissement de la progression, observé sur des échelles cliniques standardisées. De plus, l’effet apparaît plus net au début de la maladie, quand l’atteinte reste légère. En revanche, l’ampleur du gain reste modeste et nécessite un suivi serré, notamment par IRM régulières. Pour les proches, cela veut dire organiser des soins sur la durée, avec des rendez-vous fréquents.
La sécurité constitue l’autre pilier du débat. Des effets cérébraux spécifiques (ARIA) imposent une vigilance accrue, surtout chez les porteurs d’APOE4 et les patients sous anticoagulants. Ainsi, le choix thérapeutique se discute cas par cas, selon les risques et les préférences. Par conséquent, l’avis pluridisciplinaire et une information claire au patient sont décisifs.
Cette réalité de terrain interroge l’organisation des soins. Les services doivent anticiper les capacités d’imagerie et de perfusion, ou prévoir les formes à domicile quand elles arrivent. De plus, le coût global du parcours (prise en charge, examens, transports) pèse sur les familles. En bref, l’enjeu dépasse la seule efficacité pharmacologique dans la maladie d’Alzheimer.
Les auteurs insistent sur l’écart possible entre essais et vie réelle. Les critères d’inclusion en étude excluent souvent des comorbidités courantes, ce qui réduit la transposabilité. Aussi, l’accès dépend des critères de remboursement et de l’aptitude à réaliser les bilans biologiques et d’imagerie. Le message est clair : bénéfice oui, mais au prix d’un cadre de soins exigeant.
« La promesse de ces anticorps reste réelle, mais elle s’accompagne d’un mode d’emploi exigeant. »
Sécurité, suivi et accès : ce que vivent patients et soignants
Le suivi standard comprend des IRM de référence puis des contrôles pour dépister précocement les ARIA. Pourtant, tous les territoires ne disposent pas des mêmes ressources d’imagerie et de neurologie. Ainsi, le temps d’attente peut retarder l’initiation ou la poursuite du traitement. Cette variabilité d’accès crée des inégalités évitables.
Les équipes renforcent l’éducation thérapeutique afin d’anticiper maux de tête, confusion ou signes neurologiques inhabituels. De plus, une coordination fine avec le médecin traitant limite les ruptures de parcours. En revanche, l’arrêt temporaire du traitement peut s’imposer en cas d’anomalies radiologiques. Par conséquent, un plan de sécurité partagé rassure les familles concernées par Alzheimer.
- IRM de base avant traitement, puis contrôles planifiés
- Évaluation du risque sous anticoagulants et selon le profil APOE
- Information claire sur les ARIA et conduite à tenir
- Parcours coordonné entre neurologue, radiologue et médecin traitant
- Réévaluation régulière du bénéfice clinique et des objectifs
Traitements en cours de déploiement et décisions récentes
Désormais, Leqembi (lécanemab) d’Eisai est en phase de commercialisation en Europe depuis début avril 2024. Ainsi, cette option anti-plaques vise des stades précoces d’Alzheimer, avec un protocole strict de suivi et d’imagerie.
Biogen indique un schéma d’injection hebdomadaire à domicile pour le lécanemab, pensé pour alléger les venues à l’hôpital. En pratique, la disponibilité aux États‑Unis est annoncée à partir du 6 octobre 2025, avec un accompagnement logistique dédié.
À découvrirUn lien inattendu entre une hormone et le risque d’Alzheimer chez la femmeChez Eli Lilly, Kisunla (donanemab) avance grâce à un avis d’approbation du CHMP en juillet 2025. Par conséquent, cette immunothérapie par anticorps monoclonal pourrait élargir l’arsenal contre Alzheimer à court terme en Europe.
Roche et Genentech ont obtenu l’aval de la FDA en 2021 pour Aduhelm (aducanumab), premier anticorps de cette classe aux États‑Unis. En revanche, son déploiement a été limité par des débats sur l’efficacité clinique et par le besoin d’IRM rapprochées.
Roche développe aussi Trontinemab, un anticorps utilisant une technologie de « navette cérébrale » pour franchir la barrière hémato‑encéphalique. Ainsi, le programme en phase III pourrait améliorer la pénétration cérébrale et, peut‑être, le rapport bénéfice‑risque.
Soins symptomatiques et accompagnement utiles au quotidien
Selon France Alzheimer, le donépézil atténue temporairement les troubles cognitifs, surtout aux stades légers à modérés. De plus, il s’inscrit dans un plan de soins global, avec stimulation cognitive et soutien aux aidants.
La rivastigmine participe au contrôle des symptômes, sous forme orale ou transdermique selon la tolérance. En revanche, l’évaluation régulière guide les ajustements de dose et la poursuite du traitement.
La galantamine reste une autre option de la même famille, avec un profil proche et des contraintes de titration. Ainsi, le choix entre ces molécules repose sur la tolérance individuelle et les comorbidités.
La mémantine (Ebixa) agit sur le glutamate, en bloquant ses récepteurs pour limiter l’excitotoxicité. Par conséquent, elle cible les symptômes comportementaux et cognitifs chez certains patients touchés par Alzheimer.
Nouvelles pistes : métabolisme, orale et vecteurs innovants
Des travaux suggèrent que le sémaglutide, connu avec la marque Ozempic chez Novartis, pourrait exercer un effet neuroprotecteur. Ainsi, ces recherches visent la prévention des lésions liées à la maladie, sans se substituer aux soins validés.
À découvrirAlzheimer : le cerveau perd son rythme circadien des années avant les pertes de mémoireNovo Nordisk évalue aussi Wegovy dans cette logique métabolique, avec des hypothèses sur l’inflammation et l’insulinorésistance cérébrale. En bref, l’objectif est de réduire les facteurs de risque qui aggravent la trajectoire cognitive.
La forme orale Rybelsus (sémaglutide) fait l’objet d’un essai chez 3 600 patients au début de la maladie, avec des résultats attendus fin 2025. Ainsi, une option orale accessible renforcerait l’adhésion et l’équité d’accès dans le contexte d’Alzheimer.
Enfin, des nanoparticules ciblant LRP1 montrent, chez la souris, une restauration fonctionnelle et une meilleure clairance de l’amyloïde‑β. Par conséquent, ces vecteurs intelligents ouvrent la voie à des combinaisons thérapeutiques plus ciblées et potentiellement plus tolérables.
Crédit photo © LePointDuJour